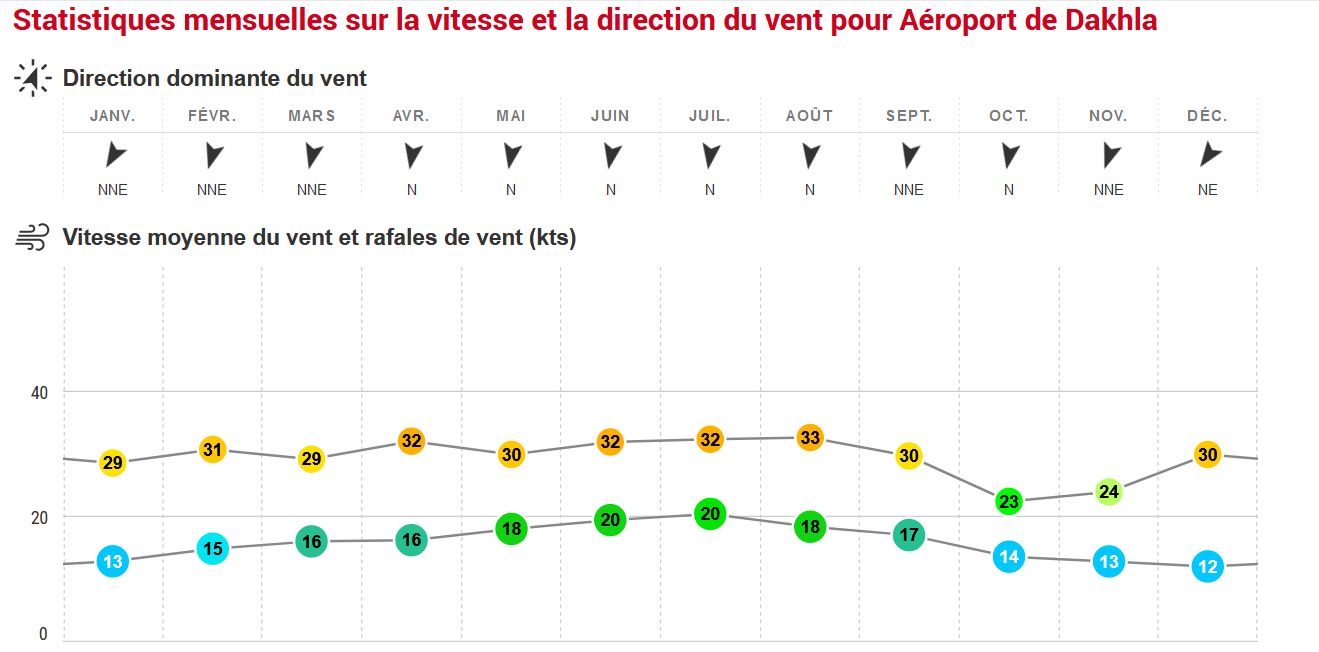
Quand Partir faire du kitesurf à Dakhla ?

✈ Top 30 des activités à faire à Dakhla, Maroc
De nombreux apprentis surfeurs qui viennent surfer à biarritz nous demandent quels sont les meilleurs films de surf. Selon Roger Ebert : Le charme particulier de « The Endless Summer » est quelque chose que je n’ai pas encore tout à fait compris dans mon esprit. C’est d’autant plus étrange qu’il s’agit ici, enfin, d’un film complètement simple, frais et naturel, conçu uniquement pour plaire. C’est vrai. Pourquoi ?
Une partie de la réponse se trouve peut-être dans l’approche peu conventionnelle du cinéaste, Bruce Brown. Il a mis dans une valise une caméra 16 mm et un assortiment de téléobjectifs et est parti un matin autour du monde, en compagnie de deux surfeurs. Avec un budget minuscule (50 000 dollars pour un film de 90 minutes en salle, c’est du jamais vu), ils se sont envolés pour la côte ouest de l’Afrique, ont goûté aux plages du Sénégal et du Ghana, puis sont descendus au Cap.
Publicité
Après avoir surfé sur les plages de l’océan Indien et de l’océan Atlantique de la péninsule du Cap, ils ont remonté la côte sur 1 000 miles en auto-stop jusqu’à Durban le long de la célèbre Garden Route, et ont trouvé, au cap Saint-François, la « vague parfaite » – une boucle d’un mètre de long qui donnait des tours de 15 minutes et qui arrivait si régulièrement qu’on avait l’impression qu’elle était « faite par une machine ».
D’autres arrêts ont eu lieu en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Tahiti et à Hawaii. La dernière a fourni des images à couper le souffle du « Pipeline », une énorme vague de grande force roulant sur un fond corallien.
Brown raconte ces aventures avec la nonchalance et l’exagération d’un passionné de home cinéma. « Les chances contre une vague comme celle-ci sont de 20 000 000 contre 1 », dit-il avec émerveillement après avoir découvert la vague parfaite. Les chances de qui ? Il utilise le mot « unique » comme s’il était un vendeur d’antiquités. Son attitude envers les nations qu’il traverse est essentiellement celle d’un garçon de fraternité aux grands yeux. « Quand ces indigènes sont venus pagayer », dit-il, « nous ne savions pas s’ils venaient pour surfer — ou pour dîner. »
Ce qui est drôle, c’est que cette exagération de seconde zone et cet enthousiasme désinvolte sont exactement ce dont le film a besoin. Quand vous êtes sur la plage et que les vagues sont bonnes, qui peut s’embêter à trouver les bonnes cotes ? Et quelle différence cela fait-il, de toute façon ?
Si le film lui-même offre exactement ce qu’il promet – 91 minutes de réalisation de voeux – la manière dont il est filmé doit offrir la même chose aux cinéastes professionnels. Fuyant les tonnes de matériel habituellement emportées sur place, Brown n’a utilisé que ce qu’il pouvait transporter. Les magnifiques photographies qu’il a ramenées à la maison font presque se demander si Hollywood n’a pas fait trop d’efforts.
Contenus de la page
Endless Summer 2
« The Endless Summer II » est la suite d’un film réalisé avant la naissance de Weaver ou de O’Connell. Le film original « The Endless Summer » est sorti, selon Brown, en 1964, bien que les livres de référence citent l’année 1966 et que je me souvienne avoir rencontré Brown lors de la sortie du film à Chicago en 1967. Rien de tout cela n’a la moindre importance, mais tout au long du film, je n’ai cessé d’être distrait par l’insistance de Brown sur l’année 1964 – peut-être parce qu’il y avait si peu d’autres choses auxquelles je pouvais penser.
Le film est merveilleusement photographié. Dès le début, on voit des plans fabuleux de vagues et de surfeurs. Certains plans vont même à l’intérieur du « tonneau », de sorte que nous pouvons voir la vague se courber au-dessus de la tête du surfeur. Quelle façon de s’exciter ! Ce sont des prises de vue formidables. On les voit encore, et encore, et encore. Le mot-clé du titre est « sans fin », pas « été ».
Publicité
À la recherche de vagues parfaites, nous suivons les gars dans leur odyssée, de la Californie du Sud au Costa Rica, à la France, à l’Afrique du Sud, aux îles Fidji, à l’Australie, et de retour chez eux, avec quelques images d’Hawaï, même si Pat et Wingnut n’y sont inexplicablement pas allés. Au cours de leur voyage, ils rencontrent les vétérans bronzés du premier film « The Endless Summer », qui ont tous maintenant 30 (ou 28, ou 27) ans de plus, mais qui traînent toujours sur la plage. De temps en temps, il y a une petite pépite d’information, par exemple : « Il y a huit millions de Zoulous en Afrique du Sud, mais un seul d’entre eux est un surfeur ». Curieusement, les cinéastes ont trouvé cela très zoulou, et l’interviewent sur le seul sujet dont il ne peut pas discuter avec ses 7 999 999 compatriotes zoulous. C’est un film avec une vision étroite.
Bien que le film dure 95 minutes, il ne contient pas beaucoup d’informations sur le surf. Il observe qu’en 1964, les surfeurs utilisaient surtout des planches longues, mais qu’aujourd’hui ils utilisent des planches courtes.
Il ne mentionne pas les différences entre les deux planches, ni les raisons pour lesquelles l’une ou l’autre pourrait être utilisée. Nous n’apprenons pas non plus comment vous apprenez à surfer, ni quelles sont les techniques et les compétences utiles. Nous apprenons qu’il existe un « pro tour », mais il n’y a aucune information sur la façon dont le sport est noté ou sur le déroulement des compétitions. Brown semble essentiellement intéressé par le fait de trouver de belles vagues, de les surfer et d’être « stoppé ». Il entrecoupe ses scènes de surf de divers éléments de couleur locale, comme lorsque Pat et Wingnut traversent une réserve animalière dans un buggy de plage et sont poursuivis par des lions. C’est risqué, mais pas aussi perturbant que les plages de France où les jeunes se retrouvent avec plusieurs seins et demandent aux surfeurs locaux où regarder en cas d’urgence.
Il y a une telle innocence inoffensive dans tout cela que c’est séduisant. Les surfeurs, comme tous les amateurs, ont une certaine folie : Ils voient le monde à travers le prisme de leur spécialité. Rien d’autre n’a d’importance. « Si vous passiez une journée à chaque endroit où les surfeurs surfent sur les vagues », nous dit le film avec nostalgie, « il vous faudrait 50 ans pour aller les visiter tous ». Mais bon sang, quand tu y arriveras, tu seras content.
Big Wednesday, le film
Dans le cadre de la série de films préférés de nos auteurs, Maxton Walker chante les louanges d’un film de surf avec des mecs, de la poésie et un grand cœur
Point Break a beaucoup à répondre. Kathyrn Bigelow a dépassé les bornes, le festival homoérotique des copains de surf est devenu le film de surf de notre époque. Et c’est une injustice monstrueuse. Tout aficionado de Point Break qui décide de regarder Big Wednesday sera instantanément frappé par l’énorme dette que Bigelow doit à l’hommage libre de John Milius à l’hédonisme californien des années 1960.
Le Big Wednesday suit trois jeunes surfeurs de 1962 à 1974, alors qu’ils attrapent des vagues, se battent, font l’amour et essaient – avec succès dans l’ensemble – d’éviter de grandir. Il n’y a pas d’homoérotisme sur ces rivages. Rencontrez Matt (Jan-Michael Vincent), le plus grand surfeur de sa génération, qui fait face aux exigences de la paternité en devenant peu à peu un clochard de plage. Il y a Leroy le Masochiste, joué par Gary Busey (un personnage qu’il a repris dans chacun de ses films suivants, dont Point Beak), et Jack (William Katt), l’ennuyeux, qui part au combat au Vietnam.
Et puis il y a l’homme connu seulement sous le nom de Bear, la réponse du film à Obi-Wan Kenobi, qui fabrique les planches de surf des gars tout en philosophant sans cesse sur la nature du surf. (Ces gars vont surfer pour toujours », dit un enfant à l’Ours grizzli alors qu’il polit une planche de surf. « Personne ne surfe pour toujours », lui répond la réponse).
Milius était lui-même un surfeur à l’époque. Et il est clair pour tout le monde, surfeur ou non, que le Grand Mercredi en est un de cœur. Aucun film, en tout cas pour moi, n’a jamais été aussi proche de capturer ce qui devait être l’ambiance de la Californie dans les années 60. Il y a de la poésie dans les plans interminables de gars qui attrapent les vagues alors que les années défilent. La mer est elle-même une entité vivante, respirante, qui définit l’humeur des personnages au fil des ans : les surfeurs vieillissants parlent avec effroi d’aller « à l’intérieur des terres », de trouver du travail et d’avoir des enfants, comme si cela s’apparentait à la mort. Le soleil flamboyant de la côte ouest s’infiltre dans pratiquement chaque plan. Et c’est un film sur un moment et un lieu très particuliers. La petite amie de Jack, qui vient d’arriver de Chicago, dit : « Chez nous, être jeune était quelque chose que l’on faisait jusqu’à ce qu’on grandisse. Ici, c’est tout ».
La grande mer du mercredi
Photographie de la mer du grand mercredi : BFI
Je ne sais pas exactement pourquoi il m’a saisi quand je l’ai vu pour la première fois à la télévision dans les années 80. Il n’y a rien de plus terrifiant que de surfer, et je courrais à des kilomètres de ces gens dans la vraie vie. C’était peut-être en rapport avec le générique de début, qui est lui-même une œuvre d’art, un montage poignant de photos de surf en noir et blanc d’époque sur la musique de Basil Poledouris.
Une fois, je l’ai regardé avec un surfeur californien, qui m’a dit que non seulement c’était son film préféré mais qu’il expliquait « ce que je suis » – donc Milius a clairement capturé quelque chose de spécial. En fin de compte, ce n’est probablement pas une grande œuvre d’art. Oui, le « grand mercredi » – le jour où l’on lance le plus grand surf de mémoire d’homme, le jour où un surfeur doit se lever et prouver qu’il a ce qu’il faut – est un moment fort, mais il n’y a jamais de réel sentiment de menace ou de danger. Même l’intrigue secondaire du Vietnam semble un peu forcée, bien que ma scène préférée soit celle où les gars se présentent dans un bureau de l’armée et essaient de trouver différents moyens d’esquiver le draft du Vietnam. (Bizarrement, Milius a essayé de rejoindre les marines mais s’est vu refuser l’entrée à cause de son asthme).
Peut-être qu’en fin de compte, il ne s’agit que d’une collection exubérante de grandes scènes – mais ce que le Grand Mercredi a, c’est du cœur, ce qui, à la réflexion, est ce qui m’agace dans Point Break. Oui, c’est un voyage. Mais il faut le lyrisme et la passion du Grand Mercredi et ensuite, d’une manière ou d’une autre, il s’arrange pour s’en moquer.
Trouve-toi une autre plage, Johnny Utah.






